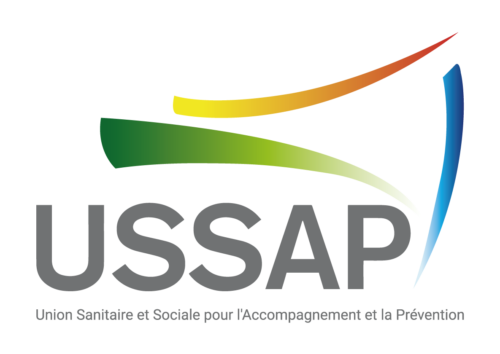Pour marquer cette journée de sensibilisation, la Maison du Razès a décidé de se mettre “tous en bleu”, couleur symbolique de l’autisme, réputée apaisante.
Cette journée est aussi l’occasion de rappeler l’évolution de nos connaissances sur l’autisme ainsi que les origines de la Maison du Razès (MAS du Razès).

Qu’est-ce que l’autisme ?
L’autisme est un trouble du neuro-développement (TND). Le mot “autisme” est utilisé pour la première fois en 1911 dans l’ouvrage Démences précoces ou groupe de schizophrénies du psychiatre suisse Eugen Bleuler. Dérivé du grec autos (soi-même), Bleuler emploie le terme autismus pour désigner une forme sévère de schizophrénie. En 1943, le psychiatre autrichien Hans Asperger développe la notion de “syndrome d’Asperger”, qu’il décrit comme une “psychopathie autistique de l’enfance”.
Dans les années 1950, Bruno Bettelheim, dans son ouvrage La forteresse vide, avance une théorie psychanalytique selon laquelle l’autisme résulterait d’une éducation déficiente, en particulier d’un manque d’affection maternelle (attitude glaciale, manque d’amour). Cette idée, bien que discréditée depuis, a causé d’importants préjudices aux familles. En 1969, Leo Kanner présente publiquement ses excuses aux mères injustement culpabilisées.
Deux courants de pensée se sont alors opposés :
- Le courant biologiste, qui explique l’autisme par des facteurs génétiques et neuro-développementaux.
- Le courant psychanalytique, qui attribue l’autisme à l’enfance du sujet.
L’autisme dans les classifications diagnostiques
L’autisme est reconnu dans le DSM-3 en 1980 sous la catégorie des “troubles globaux du développement”. En 1983, la psychiatre Lorna Wing introduit la notion de spectre de l’autisme et identifie trois signes caractéristiques :
- Troubles de la communication verbale et non verbale
- Troubles dans les interactions sociales
- Intérêts restreints et comportements répétitifs
En 1987, le DSM-3-R remplace l'”autisme infantile” par le terme “trouble autistique”, incluant les troubles envahissants du développement (TED). La loi Chossy de 1996 reconnaît officiellement l’autisme comme un trouble pouvant entraîner une situation de handicap et garantit un accompagnement pluridisciplinaire adapté.
Avec la publication du DSM-5 en 2013, l’approche diagnostique évolue : la catégorisation des TED est abandonnée au profit d’une approche dimensionnelle, aboutissant à la notion de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
La stratégie nationale 2018-2022 a ensuite structuré les dispositifs de diagnostic et d’accompagnement pour les personnes autistes et leurs aidants.
L’autisme en quelques points clés
- L’autisme est un trouble du neuro-développement.
- Ce n’est pas une maladie, mais un trouble qui peut entraîner une situation de handicap, reconnu depuis la loi Chossy de 1996.
- Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) se caractérisent par :
- des difficultés dans la communication et les interactions sociales,
- des comportements répétitifs et des intérêts restreints.
- Chaque personne autiste a des besoins d’aide différents, nécessitant une prise en charge personnalisée.
- Un accompagnement global, pluriprofessionnel, adapté et précoce est essentiel.
La MAS du Razès et l’autisme
La MAS du Razès incarne cette évolution des connaissances et de la prise en charge des TSA. Issue de la loi Chossy, elle illustre la volonté de créer des établissements médico-sociaux (ESMS) spécifiques pour éviter l’accueil inadapté des personnes autistes dans les services psychiatriques.
Ainsi, le 15 octobre 2009, une première Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) ouvre sur le site de l’Aragou (annexe du Foyer du CERS) avec 9 lits, en attendant l’achèvement des travaux d’une MAS de 30 places à Alaigne. Les premiers résidents étaient auparavant accueillis en psychiatrie, faute de structures adaptées.
Aujourd’hui encore, la MAS du Razès accompagne des personnes dont les familles ont subi les stigmates de la culpabilisation maternelle et dont la prise en charge précédente était inadaptée, voire inexistante. L’équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement individualisé, régulièrement réévalué, visant à allier sécurité et liberté de mouvement.
Mais avant tout, la Maison du Razès est un lieu de vie, avec ses rires, ses colères, ses petits et gros bobos, ses fêtes et ses adaptations constantes. Travailler là-bas signifie accepter de dépasser un cadre normatif rigide pour s’ajuster aux besoins spécifiques de chaque personne.
L’autisme peut parfois impressionner, mais il est essentiel de prendre le temps de comprendre et d’accepter la neuroatypie.
Sensibilisation et interventions
Dans le cadre de la Journée de l’autisme, la MAS du Razès interviendra à la Rouatière auprès des futurs moniteurs-éducateurs et à l’école primaire d’Alaigne, notamment pour répondre à la question des enfants : “Mais pourquoi crient-ils ?”.
Cette journée est une occasion de faire avancer les mentalités et de mieux comprendre les enjeux liés à l’autisme.
Merci à S.GRASLIN, Directrice de la MAS du Razès pour ces précisions.